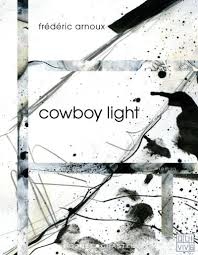07/09/2017
…et sinon, vous pouvez lire Cowboy light de Frédéric Arnoux parce que :
Parce que c'est une farce réaliste sans illusion, à hauteur d’homme, à hauteur de femme, une fable morale, sans morale.
Parce que si on regarde bien, on a tous quelque chose d’un narrateur sans nom élevé dans une famille d’accueil entre les vaches et l’usine Lip désaffectée, qu’on fantasme sur la possibilité d’une vraie maman, qu’on se fait marave par les deux tarés de la casse automobile, qu’on traficote un peu de shit, qu’on fait des virées avec ses potes, qu’on hésite pour l’avenir entre agent de maîtrise et baron de la drogue, qu’on est ouverts à l’amour fou mais un peu vénaux quand même, qu’on se prend des mandales mais qu’on en donne aussi, qu’on attend que la tragédie nous tombe sur le coin de la gueule, et que même pour ça, on finira déçus.
Parce que le bouquin se balade sur un fil et que ce fil est tendu au-dessus de trois gouffres – à gauche, le roman d’apprentissage psychologisant/larmoyant – à droite, le bon gros polar, psychanalytique, à énigme – au milieu, terrible et fumant, avec grain de beauté sur la hanche, Sophocle – et qu’il arrive au bout sans s’être vautré dans aucun des trois trous.
Parce que le bouquin contient des passages comme :
« Par exemple, un jour, elle s’est arrêtée de jouir. Le jour où elle a appris que Tonton l’a trompée. C’était peu de temps après leur mariage. Je l’ai appris tout môme par une discussion que je n’aurais jamais dû entendre. Depuis, elle écarte, il décharge, il ronfle, elle pleure. Elle a quand même voulu des enfants. » (pp.11-12)
Parce que la Franche-Comté nous intéresse ; les vaches et les usines désaffectées, les trains encore fumeurs dans les années quatre-vingt, les gueules de bois honteuses, les débiles mentaux qui se branlent devant le portrait de la Vierge Marie nous intéressent ; nous intéressent aussi les divorcées qui se mettent du rouge pour aller en boîte ; les marchands d’art héroïnomanes donnant sur le lac Léman ; et les voisins flippants à force d’être polis ; et les missions intérim jamais renouvelées – tout ça, tout ça.
Parce que, sorti au printemps 2017, le bouquin a été médiatiquement occulté par un petit événement politique ayant conduit un banquier à la tête de l’État (sans déc), et des gens du même bord à se haïr grâce à la magie des réseaux sociaux (sans blague) – et qu’il n’est jamais mauvais de remettre en perspective l’ordre d’importance des événements politiques et éditoriaux.
Parce que le bouquin contient des passages comme :
« - Ok ! Quoi ? j’ai répondu pour ne pas me faire casser les dents à coups de sandalette en plastique. » (p.23)
Parce qu’aussi le bouquin est dans la collection Qui Vive de Buchet-Chastel, ce qui se fait de plus frais à Paris, mais dites-le pas trop fort, ça ressemblerait à de la lèche.
Parce que le bouquin est dans son genre un mélo construit comme un film d’Etienne Chatiliez , qui ne mégotte ni sur la crudité, ni sur la dinguerie ordinaire, ni sur le ténébreux, le veuf, l’incestueux, dont s’enorgueillissent nos 36000 riantes communes.
(« Bébert et Jeannot avaient huit sœurs. Ils avaient tous une case en moins. Physiquement, ça se voyait sur leurs têtes. Tout le quartier les appelait « les bêtes ». Ils occupaient le rez-de-chaussée de la grosse baraque. A l’étage du dessous, il y avait deux appartements, occupés par des familles normales. Quand j’étais môme, les sœurs me couraient après en beuglant : « Donne-nous des bisous, donne-nous des bisous… » J’étais leur sex-symbole (sic) Je ne sais pas si c’est lié, mais, à l’école, je courais plus vite que tout le monde. Le Guépard, on m’appelait. En fait, j’étais surtout l’un des rares gamins avec les deux fistons à ne pas les considérer comme des pestiférés. Dans le quartier, seules la Ginou et une autre béni-oui-oui s’occupaient d’eux. Je me demandais toujours à quoi ressemblaient leurs journées, leur soirées, leurs petits bonheurs, Noël. Ils vivaient en vase clos. Les rares fois où je croisais la mère, elle avait toujours une débile agrippée au bras pour la retenir comme si elle allait s’enfuir. A croire qu’elles se relayaient pour monter la garde. La mère ne parlait pas beaucoup, souriait rarement. Personne n’entrait chez eux, même pas le soleil. » (p. 44))
Parce que ces plaies ces croûtes ce pus n’empêchent aucunement l’irruption brutale de l’imaginaire et de la féérie.
(« – Et si les nuages étaient des pets ? » tu as murmuré.
(…)
– Imagine qu’à chaque fois que Dieu se lâche, ça forme un nuage.
– Ça m’étonnerait.
– Et pourquoi ?
– Parce que la pluie pue pas. » p.126)
Parce que le bouquin est dans ma liste de livres précieux et méconnus – par exemple Squat de Yannick Bouquard ; par exemple Eboueur pour échafaud d’Abdel Hafed Benotman ; ou Kendokei de Julien Péluchon ; ou Travelling de Brigitte Fontaine – qui ne pètent pas plus haut que leur style, des trucs à lire absolument avant de dire que le roman, c’était mieux avant.
Ugh.
11:01 Publié dans Gros matos | Tags : cowboy light, frédéric arnoux, qui vive, buchet-chastel, besançon, contre-rentrée littéraire | Lien permanent | Commentaires (0)